News
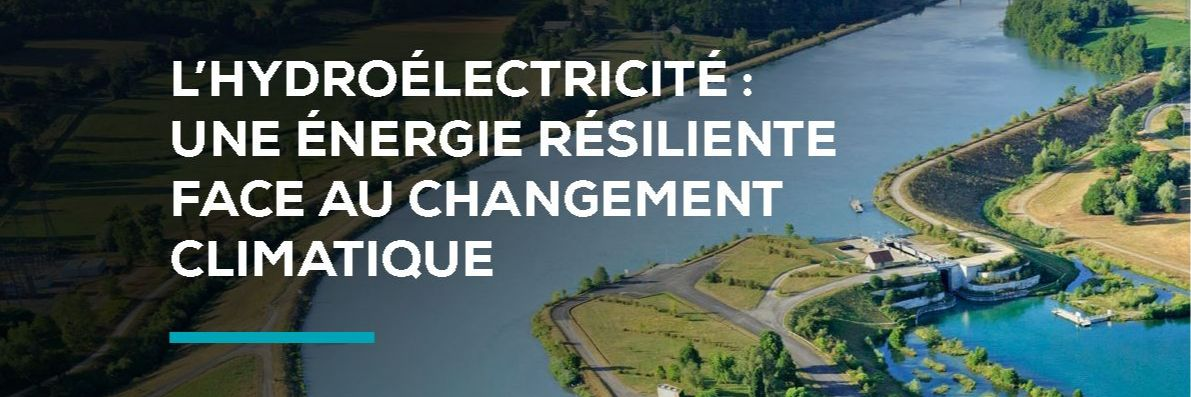
Rapport du SER - L'hydroélectricité : une énergie résiliente face au changement climatique
10 avril 2025
Hydroélectricité
Publié par
Valentin MAILLOT
Vue 877 fois
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a publié en mars 2025 le rapport "L'hydroélectricité : une énergie résiliente face au changement climatique".
Dans cette publication, le SER apporte des éléments de réponse à ces questions :
- Quel est l’impact du changement climatique sur la ressource en eau ?
- Quels sont les effets du changement climatique sur les centrales hydroélectriques ? Sur leur production ?
- Les ouvrages sont-ils adaptés aux conséquences du changement climatique ?
Les éléments à retenir
Evolution des débits
- Le réchauffement climatique va augmenter la pluviométrie en hiver (de +20 % (entre +10 % et +45 %). Elle est plus importante dans le Nord et faible, voire incertaine, dans le Sud. La variabilité d’une année à l’autre reste forte : des hivers secs ou très humides sont toujours possibles. A l’inverse, elle va diminuer en été : -25 % (entre -50 % et +5 %). La variabilité des cumuls estivaux est importante d’une année à l’autre : des étés très secs ou humides sont toujours possibles
- Le réchauffement atmosphérique va également augmenter l’évapotranspiration (évaporation des surfaces d’eau à l’air libre type retenues de barrage, transpiration des végétaux sous l’effet de la chaleur). Ainsi oour un volume de précipitations (pluies) identique, une évapotranspiration plus intense va induire une baisse de la quantité d’eau « disponible » pour l’alimentation des nappes et des cours d’eau. L’effet de ce phénomène sera particulièrement sensible en été et va contribuer à amplifier l’effet de la baisse des précipitations estivales sur les débits.
- La fonte des glaciers va temporairement augmenter le débit des cours d’eau jusqu’en 2040, puis les diminuer jusqu’à une stabilisation à leurs niveaux de 1980. En intra-annuel, la fonte des neiges débute plus tôt sous l’influence de températures plus élevées. Les pics de débit ont lieu plus tôt dans l’année et sont également plus faibles sous un effet d’étalement
- Les études prospectives concluent que le débit moyen annuel des cours d’eau reste globalement stable sur la majeure partie de la France, mais diminue dans le Sud-Ouest. En revanche, les modélisations prévoient une baisse des débits d’étiage, avec des niveaux bas sur de plus longues durées, une hausse du nombre de cours d’eau en assec en période estivale et des débits de crue plus élevés et moins prévisibles au cours de l’année.
Impacts environnementaux
- Assèchement partiel voire total de certains cours d’eau, induisant une mortalité importante sur différentes espèces (poissons, végétation aquatique, etc.) et à la concentration des pollutions modifiant l’équilibre biologique et physico-chimique de l’eau
- Les fortes crues et inondations provoquent ainsi des déplacements de la faune aquatique et une hausse de la mortalité, conduisent à une modification des habitats, de la qualité de l’eau (pollution) ou encore de la disponibilité en dioxygène. Les milieux affectés peuvent mettre plusieurs années à retrouver leur équilibre
Production hydroélectrique
- Forte variabilité de production interannuelle (+/- 20 % autour de la valeur moyenne sur les 30 dernières années)
- L’évolution du cadre réglementaire (en particulier l’augmentation du débit réservé à partir de 2006 ou le cadrage des continuités écologiques en 2014), de même que le développement des usages de l’eau sont les facteurs déterminants expliquant les baisses de production constatées. Ainsi, la filière estime que l’effet des seules évolutions réglementaires représente une perte de l’ordre de 2 % de la production hydroélectrique annuelle totale.
- Les centrales ne turbinent pas les très faibles débits, d’une part parce que leurs turbines doivent disposer d’un débit minimum pour fonctionner, mais également parce qu’elles doivent laisser passer un débit minimum dans les cours d’eau pour permettre la vie aquatique (le débit réservé). Ainsi, de nombreuses centrales sont déjà actuellement à l’arrêt durant la période estivale. Dans ces conditions, la baisse des débits d’étiage a donc une incidence relativement faible sur la production hydroélectrique. Ainsi, dans les régions de plaine et du Sud de la France, où les débits vont baisser toute l’année, quelle que soit la saison, la production hydroélectrique va baisser, mais dans une proportion nettement moindre que la baisse des débits
- En montagne, la production va augmenter sur environ deux décennies du fait de la fonte glaciaire, avant de décroître avec la disparition progressive des glaciers
- EDF estime qu’à l’échelle de son parc hydroélectrique, la perte de production moyenne due au changement climatique sur la prochaine décennie sera seulement de l’ordre de 2 % par rapport à la situation actuelle (soit une perte moyenne de 0,2 % par an)
Rôle de l’hydroélectricité pour l’adaptation au réchauffement climatique
- En période de crue, les aménagements hydroélectriques peuvent stocker de l’eau pour réduire les débits à l’aval et contribuer ainsi à limiter les impacts sur les biens et les personnes
- En stockant de l’eau lorsque les apports sont importants, les retenues hydroélectriques permettent de la restituer en période de sécheresse et d’assurer ainsi un débit minimum dans les cours d’eau. Ceci est déterminant pour maintenir la biodiversité, mais également pour assurer la continuité d’usages anthropiques importants comme l’alimentation en eau potable, l’irrigation, le refroidissement de sites industriels ou encore les activités de loisirs
- Lorsque les rivières s’échauffent fortement, des lâchers d’eaux depuis les réservoirs peuvent contribuer à faire baisser la thermie des cours d’eau et à préserver ainsi les écosystèmes
- Les aménagements (canaux, retenues ou réservoirs) peuvent servir de refuge à la faune en période d’extrême sécheresse estivale, ainsi qu’il a par exemple été constaté en 2022, année durant laquelle de très nombreux cours d’eau ont été totalement à sec.
- Antagonisme entre les besoins environnementaux et énergétiques qui nécessite une vision intégrée, des arbitrages et des mécanismes de compensation : le lissage des crues implique des retenues en périodes de forts apports et le soutien d’étiage nécessite de déstocker de l’eau en été. Or, la valeur de l’hydroélectricité pour le système électrique est de disposer de stocks importants (donc des retenues pleines) pour produire lors des pointes de consommation, généralement observées en hiver, évitant ainsi d’appeler des moyens de production thermiques fossiles, ce qui conduit schématiquement à avoir des retenues pleines en début d’hiver et vides en début d’été.
Travaux à réaliser sur les centrales hydroélectriques
- Augmenter la flexibilité de fonctionnement des turbines ou ajouter des groupes de plus faible puissance, pour turbiner des débits plus faibles à l’étiage
- Augmenter les capacités des retenues pour stocker les précipitations d’évènements extrêmes plus marqués : des sites peuvent se prêter à une réhausse des barrages, ou à une augmentation de leur fréquence de remplissage par le biais d’un pompage de l’eau
- Améliorer le rendement (rapport entre l’énergie électrique produite et l’énergie de l’eau disponible) des installations. Ex : le remplacement de la turbine et des injecteurs sur le groupe 9 de la centrale hydroélectrique de Grand Maison (plus grand barrage d’Europe ; à lui seul 9 % de la puissance hydroélectrique d’EDF) devrait permettre de gagner 10 % de puissance installée.
- Suréquiper les sites dont le potentiel n’est pas entièrement exploité (hauteur de chute et/ou débit).
Le développement du potentiel de l’hydroélectricité
- On entend souvent que la France a exploité la totalité de son potentiel hydroélectrique : c’est faux. La Stratégie française énergie climat (SFEC) propose de développer à l’horizon 2035 les capacités de la filière à hauteur de 2 800 MW de puissance installée par rapport à 2022. (soit 1,7 fois la puissance de l’EPR2 de Flamanville). Cela représenterait une augmentation de 10 % de la capacité hydroélectrique française (25 460 MW installés actuellement)
- Extrait de la PPE3 dont la consultation s’est terminée le 5 avril : « La PPE 2 fixait comme objectif d’engager les démarches permettant le développement de STEP pour un potentiel de 1,5 GW, en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. Dans cette optique, une consultation publique a été lancée au printemps 2023 pour déterminer le cadre économique propice au développement des STEP et l’éventuelle nécessité d’un soutien public. Ces travaux se poursuivent et pourront notamment être mis en œuvre lors de la procédure d’attribution de la nouvelle concession de STEP des Lacs blanc et noir, dans le Haut-Rhin, pour laquelle une procédure d’octroi est en préparation. En outre, un avenant à la concession de Saut-Mortier a approuvé en janvier 2024 le nouveau projet de STEP d’une puissance de pompage de 18 MW permettant de développer la flexibilité énergétique de la chaîne hydroélectrique de l’Ain (450 MW) et de mieux concilier les usages autour de la ressource en eau ». (référence pour la STEP des Lacs Blanc et Noir : c'était la première «station de transfert d’énergie par pompage » (Step) de France. Cette première construction a été détruite lors d' une inondation catastrophique, le 4 janvier 1934. Une trombe d'eau a fait neuf morts et des dégâts matériels considérables. Une nouvelle centrale a été construite, mais à son tour, elle cessé de fonctionner en 2002, suite à une avarie. A l'arrêt jusqu'en 2008, la concession est reprise un an plus tard par EDF qui la démonte et s'engage à reconstruire, mais rien n'est fait, l'électricien décide même d'abandonner la concession. La concertation lancée en 2023 devrait permettre d’aboutir à une mise en service en 2030)
- Dans le cadre des travaux de planification énergétique, le Ministère de la transition énergétique a actualisé en 2022 l’étude sur le potentiel hydroélectrique des cours d’eau français et identifié près de 11 TWh supplémentaires, soit l’équivalent de la consommation de 5 millions de Français, qui pourraient être produits grâce à la construction de nouvelles centrales hydroélectriques.
 3
3









Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.